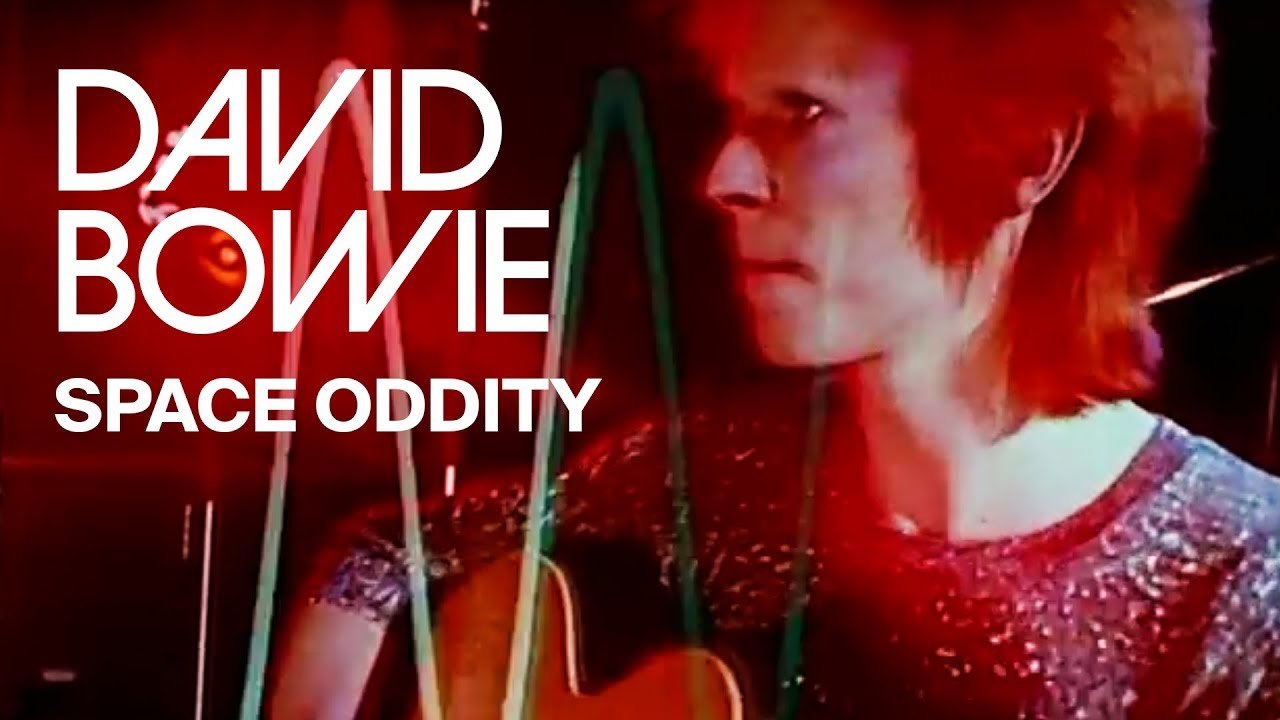Sur la terre comme au ciel.
Le Noir de l’étoile de Gérard Grisey
Lambert Dousson
« Que l’on n'en déduise pas cependant que je suis un adepte de la musique des Sphères ! Il n’est d’autre Musique des Sphères que la Musique Intérieure. Celle-là seule pulse encore plus violemment que nos pulsars et oblige de temps à autre un compositeur à rester à l’écoute. »
— Gérard Grisey, Le Noir de l’étoile
1967, Observatoire de radioastronomie Mullard, Laboratoire Cavendish, Université de Cambridge, Grande-Bretagne. Alors qu’elle effectue sa thèse de doctorat sur les trous noirs, l’astrophysicienne Jocelyn Bell remarque une anomalie dans les enregistrements du radiotélescope avec lequel elle sonde l’espace. En effet, comme le rappelle Jeffrey A. Brown, auteur d’une récente biographie de Gérard Grisey, « la grande majorité des signaux astronomiques sont soit des signaux transitoires, causés par des événements uniques et violents tels que l’explosion d’une étoile ou la formation d’un trou noir ; soit des signaux erratiques, c’est-à-dire des radiations émises de manière irrégulière par les éruptions solaires et les orages magnétiques sur des planètes lointaines. » Or les relevés du radiotélescope contiennent un signal radio étonnamment régulier, présentant des impulsions périodiques espacées de exactement 1,337301130 seconde.
Ce phénomène est l’année suivante baptisé « pulsar », mot-valise composé de « pulsating » et « star », « étoile pulsante », par l’astronome Anthony Hewish. Or celui-ci n’est autre que le directeur de thèse de Bell. C’est également la signature d’Hewish qui figure en premier dans l’article que fait paraître quelques mois plus tard la prestigieuse revue Nature pour rendre compte de cette découverte. Et c’est Hewish encore qui, en 1974, est récompensé du prix Nobel de physique « pour son rôle décisif dans la découverte des pulsars ». Une partie de la communauté scientifique s’indigne alors de l’invisibilisation de Jocelyn Bell, qui a entre-temps obtenu son doctorat, en 1968. Quarante ans plus tard, cette dernière déclarera :
« On peut actuellement s’en tirer extrêmement bien sans avoir obtenu de prix Nobel, et j’ai obtenu de nombreux autres prix, et tellement de récompenses et d’honneurs que, en réalité, je pense que je me suis bien plus amusée que si j’avais eu le prix Nobel. Le prix Nobel est une sorte de feu de paille : vous le recevez, vous êtes heureuse le temps d’une semaine, puis tout est terminé, plus personne ne vous remet quoi que ce soit après, parce qu’on croit que rien ne peut être au même niveau. » (Beautiful Minds, BBC, 2010)
Reste que la découverte des pulsars constitue un exemple caractéristique de ce que l’historienne des sciences Margaret W. Rossiter a nommé en 1993 « effet Matilda », en référence à la militante féministe américaine Matilda Joslyn Gage qui, dans son essai Woman as inventor (1883), pointait la tendance récurrente des hommes à s’attribuer les mérites des découvertes de leurs consœurs, quand ils ne leur volent tout simplement pas leurs idées. Processus d’invisibilisation sexiste, l’« effet Matilda » désigne ainsi la spoliation ou la minimisation systémique de la contribution des femmes à la recherche scientifique.

━━━━
1985, quartier de Berkeley Hills, 1934 San Antonio Avenue — à quelques minutes en voiture de l’Université de Californie à Berkeley, une maison face à l’océan Pacifique.
« Il avait des petites amies, des maîtresses. Ça n’a pas toujours été facile pour moi […]. Il me disait : “Tu es mon point d’ancrage. Même si j'ai besoin d’autres femmes, j'ai aussi besoin de toi”. Ça m’a aidée. Je l’ai aidé à écrire sa musique, je me suis occupée de sa vie quotidienne. J’étais convaincue qu’il était un bon musicien, alors je me disais : “Bien sûr, une autre femme pourrait faire ce que je fais, mais je suis là.” »
C’est une autre Jocelyne qui parle ici : Jocelyne Grisey, qui en 2020 raconte à Jeffrey A. Brown la décision que prend subitement en 1983 Gérard Grisey, son mari, de la quitter malgré tout. Elle qui était venue l’accompagner à Berkeley, après l’avoir suivi à Berlin, n’a donc plus de raison de rester en Californie. Elle rentre à Paris, avec leur fils, durant l’été. Le compositeur va alors traverser une très profonde dépression, éprouvant « une solitude émotionnelle, morale et culturelle indescriptible », comme il l’écrit en février 1984 à ses amis parisiens, transpercé de pensées suicidaires, « incapable de composer le moindre son ». Sa rencontre avec France Detry durant l’automne de la même année lui permettra de sortir de ce marécage. Il se remet alors à écrire de la musique, et la correspondance passionnée entre les deux amants se peuple de deux œuvres tout particulièrement : Les Chants de l’amour (1982-1984, pour 12 voix mixtes et bande), dédié « à tous les amants de la Terre », qu’il est en train de terminer, et Le Noir de l’étoile (1989-1990), qu’il dédiera à son fils et aux Percussions de Strasbourg, et dont la gestation sera plus longue.
C’est dans ce contexte de mort et de naissance douloureuses de l’amour que Grisey fait en 1985 la connaissance, au cours d’une soirée, d’un astrophysicien d’origine britannique de quatre ans son aîné, Joseph « Joe » Silk. Celui-ci se sent aussi seul au département d’astronomie que Grisey au département de musique. La recherche scientifique sur la naissance et la mort des étoiles de l’un rencontre alors la recherche artistique du second sur la naissance et la mort des sons. C’est ainsi que Grisey apprend l’existence de ces petites étoiles mortes nommées pulsars.
Tout au long de sa première vie, une étoile rayonne de sa propre lumière par réactions de fusion nucléaire. Certaines étoiles, les plus petites, peuvent briller durant 50 milliards d’années. Plus elles sont massives, plus leur vie est brève : à peine quelques millions d’années pour les supergéantes. C’est de la mort de ces dernières que sont issus les pulsars.
Lorsqu’une étoile supergéante a épuisé tout son combustible nucléaire, son noyau subit un effondrement gravitationnel : il se contracte, s’écrase sur lui-même en une fraction de seconde. Cet « effondrement de cœur » s’accompagne d’une explosion, appelée supernova. Certaines supernovæ (les plus massives) engendrent des trous noirs. D’autres font naître des étoiles à neutrons, corps célestes d’une extrême densité, de l'ordre de mille milliards de tonnes par litre, dont la masse est équivalente à trois fois celle du soleil pour un diamètre de 20 à 40 kilomètres seulement. Certaines étoiles à neutron possèdent une vitesse de rotation très élevée qu’elles ont acquise à leur naissance, et un champ magnétique très puissant qui émet des ondes électromagnétiques — de la lumière. Du fait que leur axe de rotation n’est pas aligné avec leur axe magnétique, elles projettent dans l’espace un mince faisceau de radiations, comme un phare dans l’océan, qu’un observateur percevra comme une émission pulsée, d’où leur nom de pulsar.
Sur terre, les signaux radio qui suivent comme une ombre ces ondes électromagnétiques, sont captés par les radiotélescopes, convertis en signaux électriques et amplifiés pour les étudier. Si l’on y connecte un haut-parleur, la membrane se met alors à vibrer au rythme de ses pulsations.
L’astrophysicien fait entendre au compositeur le chant du pulsar de Véla, résidu de l’explosion de la supernova éponyme il y a environ 12 000 ans, qui tourbillonne sur lui-même à raison de 11 rotations par seconde.
Dans la note de programme du Noir de l’étoile, Grisey dit de cette expérience : « Je fus séduit. »

Observatoire astronomique
table ronde
Écouter les étoiles : pulsars et rythmes de l’univers
Jérôme Novak
Micaela Oertel
Pierre Maggi
━━━━
15 juin 1979. Le pulsar observé par Jocelyn Bell en 1967, baptisé CP 1919 pour « Cambridge Pulsar à 19h19 d’ascension droite », entre dans l’histoire de la musique.
Non pas sous la forme d’un son, mais d’une image : un diagramme, qui met en évidence la régularité de son signal électromagnétique en alignant verticalement le relevé des ondes radio découpées en périodes. Le graphique, intitulé 100 Consecutive Pulses from the Pulsar CP 1919, a été dessiné à l’ordinateur par le jeune astrophysicien Harold J. Craft, pour sa thèse sur les pulsars réalisée en 1970 à l’Observatoire astronomique d’Arecibo à Porto Rico. Il a notamment été reproduit dans The Cambridge Encyclopaedia of Astronomy que feuillète à ses heures perdues dans la bibliothèque centrale de Manchester Bernard Sumner, guitariste du groupe Joy Division.
La pochette d’Unknown Pleasures, le premier album studio du météore Joy Division, est formée du diagramme seul, blanc sur fond noir après que le designer Peter Saville en a inversé les valeurs. Sur la couverture ne figurent ni le nom du groupe, ni le titre de l’album.
Unknown Pleasures parle de mal-être et d’isolement, de corps qui ne répond plus et de sensations qu’on ne parvient pas à éprouver. Aucune chanson composée par Ian Curtis ne parle des étoiles.

━━━━
Automne 1982, Université de Californie à Berkeley (États-Unis), département de musique : « I don’t do drugs, I don’t need to space out » (Je ne me drogue pas, je n’ai pas besoin de planer).
Andrew Imbrie (1921-2007), qui enseigne la composition à Berkeley depuis 1949, ne trouve rien d’autre à dire en boucle à ses étudiants depuis qu’il a entendu en concert des œuvres du jeune collègue français qui vient d’obtenir un poste d’Assistant Professor en composition, Gérard Grisey. « You know, I don’t smoke marijuana » : c’est tout ce qu’il trouve à dire à l’écoute de la première partie des Espaces acoustiques, composée entre 1974 (Périodes, pour 7 instruments) et 1975 (Partiels, pour 18 musiciens). Invité l’été de la même année à Darmstadt pour présenter ce qu’on appelle la musique spectrale dans le centre de pèlerinage de la musique sérielle, Grisey, avec ses amis de l’ensemble l’Itinéraire, a déjà eu à subir le mépris de ses collègues allemands. Quand on pense à l’influence gigantesque de son œuvre sur la musique d’aujourd’hui, et singulièrement de Vortex Temporum (1994-1996), qui a essaimé dans toutes les esthétiques au XXIe siècle, une telle surdité a de quoi donner le vertige.
Toute inepte qu’elle est, la remarque d’Imbrie n’en est pour autant pas totalement dénuée de sens. La raison en est qu’elle confère à son dégoût et son ignorance une dimension culturelle ou idéologique, dont l’anachronisme fait symptôme. En somme, Imbrie prend Grisey pour un adepte de Stockhausen et confond Les Espaces acoustiques avec Stimmung. Bien que parfaitement erronée, cette confusion nous permet cependant de préciser la relation de Grisey aux étoiles.
Grisey a suivi les cours de Ligeti et Stockhausen à Darmstadt en 1972, lorsqu’il était pensionnaire à la Villa Médicis. D’Atmosphères (1961) à Clocks and Clouds (1972) en passant par Lux Aeterna (1966), Ligeti démontre à Grisey la possibilité d’événements musicaux microphoniques survenant à l’intérieur d’un espace macrophonique étale et continu. Mais c’est Stimmung (1968) qui lui révèle peut-être le plus profondément comment mettre en musique la vie intérieure d’un son. L’œuvre hypnotique de Stockhausen déploie durant soixante-douze minutes le même accord consonnant issu des harmoniques naturelles d’un si bémol grave, animées intérieurement de pulsations répétées, superposées, déphasées, à l’époque où Terry Riley et Steve Reich composent leurs premières œuvres minimalistes, fondées sur des processus semblables.
Pour éclairer la dimension méditative et mystique de Stimmung, on a invoqué l’imprégnation de la pensée orientale et les tendances new age de la culture hippie — Stockhausen a enseigné la composition à l’Université de Californie à Davis entre 1966 et 1967, année du « Summer of Love » —, que Sirius (1975-1977) puis Licht (1977-2003) projetteront dans l’espace intersidéral, voir « Space is the place : Stockhausen, Sirius et la science-fiction ».
Parallèlement, dans la culture pop, le rock psychédélique (dit parfois aussi space rock), issu de la culture hippie, déploie dans ses chansons la thématique du voyage dans le cosmos. Celui-ci cristallise la projection utopique d’une société extra-terrestre fondée sur la paix et l’amour aussi bien qu’une métaphore du trip sous LSD — ce qu’entend Imbrie quand il écoute Les Espaces acoustiques de Grisey. La même année où se tient le festival de Woodstock (15 au 18 août 1969) et qu’Armstrong foule le sol de la lune (21 juillet 1969), David Bowie dépeint, dans la musique et les paroles de « Space Oddity », un Major Tom abandonné à sa propre mort dans un espace interstellaire colonisé et marchandisé par un complexe militaro-industriel qui lui demande de faire la promotion d’une marque de vêtements (« This is Ground Control to Major Tom / You’ve really made the grade / And the papers want to know whose shirts you wear »). Son homme venu des étoiles, son « Starman », préférera en 1972 rester à distance des êtres humains. « La volonté d’unir les esprits, pour moi, pue l’époque “flower power” à plein nez. Rapprocher les gens me paraît obscène », confie-t-il à William Burroughs dans un dialogue publié en 1974 dans le magazine Rolling Stone. En 1979, Joy Division réduit l’espace à un diagramme métaphorisant les heurts de la « musique intérieure » (pour reprendre l’expression de Grisey) de Ian Curtis. Cimetière du « peace and love », l’espace des années 1980 est le théâtre d’une guerre des étoiles : pas le conte de fée raconté par George Lucas au cinéma, mais le projet militaire conçu par Ronald Reagan de défense anti-missile pour protéger les États-Unis d’une frappe nucléaire. Un vide où personne ne vous entend crier, encore moins chanter.
Fervent catholique durant sa jeunesse, Grisey, devenu compositeur, a pour seule religion celle de l’art. La référence scientifique — l’analyse spectrographique des sons — qui irrigue les titres de ses œuvres, « souvent abstraits et mêmes pudiques », ainsi qu’il l’indique à Guy Lelong en 1988, maintient sa musique à distance de la tentation new age. Enfin, comme le rappelle Luminet, l’espace n’a, physiquement parlant, rien d’harmonieux :
« Au xxe siècle, l’astrophysique a quelque peu rendu cacophonique la fragile harmonie des sphères de Pythagore et de Kepler, en dévoilant l’incessante agitation cosmique. Le ciel apparaît aujourd’hui comme un espace de bruits — rythmes, crépitements, longs hululements ou brèves fulgurances. De vastes nuages d’hydrogène se fissurent pour accoucher de nouveaux astres ; des étoiles, épuisées d’avoir brillé, explosent en supernovæ ; des pulsars cliquètent en tournoyant ; des trous noirs engloutissent la matière et la lumière dans des puits sans fond ; des galaxies font gicler leur gaz en immenses jets de millions d’années-lumière. »
━━━━
Bruxelles, 27 juillet 1988. De retour en Europe depuis 1986, Gérard Grisey écrit à l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet à l’Observatoire de Paris (situé à Meudon) sur les recommandations de Joe Silk :
« Celui-ci m’a fait entendre quelques enregistrements de pulsars. Depuis, la beauté de certains de ces sons m’a fait tant rêver et réfléchir que j’ai décidé de composer une pièce assez longue, probablement pour orchestre et quelques moyens électroniques qui prendrait pour matériaux des sons de pulsars. Ceux-ci seront le point de départ et de référence de la structure musicale ».
Lui-même pianiste et observateur attentif de la création musicale, Luminet connaît déjà la musique de Grisey — il possède chez lui un enregistrement 33 tours réunissant Partiels et Dérives. Le 13 septembre, l’astrophysicien répond avec enthousiasme à la proposition du compositeur, ajoutant qu’il a déjà été approché par deux autres artistes également fascinés par les pulsars. Entre les deux hommes une amitié se noue vite. C’est notamment Luminet qui inspire à Grisey le titre d’une œuvre qui va l’occuper entre 1988 et 1989, Le Temps et l’écume (pour 4 percussionnistes, 2 synthétiseurs et orchestre de chambre), issu d’une récente théorie qu’il décrit dans son essai sur Les Trous noirs :
« La géométrie de l’espace-temps microscopique doit être turbulente et en perpétuel changement, agitée de fluctuations quantiques. On peut la comparer à la surface d’un océan. Vu d’avion, l’océan paraît lisse. À plus basse altitude, la surface reste continue mais on commence à percevoir quelques mouvements qui l’agitent. Examiné de près, l’océan est très tumultueux, discontinu même puisque des vagues se brisent, projetant des gouttes d’eau qui s’élèvent et retombent. De la même façon, si l’espace-temps paraît continu à notre échelle, son écume deviendrait perceptible à l’échelle de la longueur de Planck [env. 10-35m] et produirait des gouttes se manifestant à nous sous forme de particules élémentaires. »
L’esthétique musicale de Grisey, depuis Dérives (1973-1974, pour petit ensemble et grand orchestre), vise quant à elle à donner à entendre la multiplicité d’événements et d’accidents qui animent tout son de l’intérieur, à travers l’effet d’amplification et de simulation opéré par la « synthèse instrumentale », agissant comme un immense microscope pointé vers le son. Mais la découverte de cette théorie correspond à un moment où le compositeur réfléchit à la possibilité de superposer des vitesses — c’est-à-dire des échelles du son — entre ce qu’il nomme le temps humain (temps du langage), le temps des insectes et des oiseaux, contracté à l’extrême, et le temps dilaté des baleines, qu’après Le Temps et l’écume on entendra dans L’Icône paradoxale (1992-1994, pour 2 voix de femme et grand orchestre) et Vortex Temporum (1994-1996, pour piano et 5 instruments). Cette nouvelle préoccupation pour l’accélération, contemporaine d’Épilogue (1985, finale des Espaces acoustiques, pour 4 cors et grand orchestre) et Talea (1985-1986, pour 5 instruments), est liée à des rencontres musicales nouées dans la solitude affective de la Californie, comme il l’écrit dans des pages de son journal, de passage à Paris, en 1984 :
« Je découvre à quel point il est temps pour moi d’ajouter rupture et rapidité à l'obsession de la continuité et à la lenteur du processus. Est-ce l’influence de la musique africaine ou du jazz découvert lors de mon séjour en Californie ? Est-ce la découverte de Conlon Nancarrow — le plus grand rythmicien depuis Stravinsky — et sa musique d’insectes, où le temps contracté stimule notre perception exacerbée jusqu'à l’irritation ? Est-ce l’évidence de Janáček dont je déchiffrais alors les opéras, et de ces continuelles et abrupts interruptions de tempi ? »
À ce désir de rupture et de rapidité, le pulsar du Noir de l’étoile apporte une réponse venue du ciel :
« La réponse vint lentement : les intégrer dans une œuvre musicale sans les manipuler ; les laisser exister simplement, comme des points de repère au sein d’une musique qui en serait en quelque sorte l’écrin ou la scène ; enfin, utiliser leurs fréquences comme tempi et développer les idées de rotation, de périodicité, de ralentissement, d’accélération et de “glitches” [modifications brutales de la vitesse de rotation] que l’étude des pulsars suggère aux astronomes. La percussion s’imposait car, comme les pulsars, elle est primordiale et implacable et, comme eux, cerne et mesure le temps, non sans austérité. Enfin, je décidai de réduire l’instrumentarium aux peaux et métaux, à l’exclusion des claviers. »
Le premier mouvement du Noir de l’étoile reprend ainsi dans son intégralité Tempus ex machina. Composée pour les Percussions de Strasbourg, et créée à Montréal par l’ensemble à percussion de l’Université McGill (aujourd’hui ensemble Sixtrum) en 1979 (l’année où Joy Division sort Unknown Pleasures), cette œuvre mettait déjà en action les phénomènes d’accélération, de décélération et de déphasage. Au bout d’une vingtaine de minutes, des figures en cascades d’une grande brutalité imposent un silence d’où émerge, seule, tournant autour du public à travers douze haut-parleurs deux minutes durant, la pulsation rapide du pulsar de Véla, qui avait séduit Grisey en Californie. On entend la « contamination de la vitesse du pulsar aux percussionnistes » (Luminet), ouvrant une musique qu’on croira plus tard reconnaître durant le « Faux Interlude » qui précède « La mort de l’humanité », dernier des Quatre chants pour franchir le seuil (1996-1998, pour soprano et 15 instruments), l’ultime œuvre que Grisey compose avant de mourir. Le gigantesque processus de ralentissement auquel on assiste à ce moment se voit interrompu par un tutti frénétique qui introduit au second pulsar, baptisé 0329+54. Celui-ci, précise Luminet, « effectue 1,4 tour par seconde (quatre-vingt-quatre coups à la minute, le rythme d’un battement cardiaque). La supernova qui l’a engendré a explosé il y a 5 millions d’années et ses impulsions radio mettent 7500 ans pour parvenir à la Terre. » Le soir de la création du Noir de l’étoile, le 16 mars 1991 au Festival Ars Musica de Bruxelles, dans une scénographie conçue par Claudia Doderer, on fit débuter l’œuvre à 17h00 afin de retransmettre en direct les signaux du pulsar 0329+54, qui arrivaient à 17h46 précises en provenance du radiotélescope de Nançay dans le département du Cher. Sa solitude sonore est à son tour violemment brisée par un retour des percussions, mobilisant un nouveau matériau, le métal. Le « pulsar imaginaire » tourbillonnant dans le dernier mouvement du Noir de l’étoile fait enfin entrer les instruments dans un délire musical où toute forme de régularité se voit pulvérisée.
━━━━
C’est en vain qu’on cherchera dans l’œuvre de Gérard Grisey une référence à la musique pop. N’empêche que le délire final du Noir de l’étoile a quelque chose d’irrésistiblement jazzy. Mais cela ne vient en aucune manière des étoiles, puisque le pulsar est, de l’aveu de Grisey, non un matériau, mais un objet trouvé, à l’image de « la vieille selle de bicyclette » de Picasso que le compositeur évoque dans la notice de l’œuvre. On ne saurait faire plus prosaïque et moins éthéré. La structure du Noir de l’étoile — les proportions, les tempos — est elle-même tout entière déduite, non des pulsations de Véla ou de 0329+54, mais de Tempus ex machina, qu’il a composée dix ans auparavant. Dès lors, si ce n’est des pulsars, d’où provient cette énergie ?
« En écoutant les percussions du Mali au Centre George Pompidou, je me disais que cette musique avait en abondance exactement ce qui nous manque, ce que nous refusons obstinément à la musique contemporaine pour la laisser entièrement aux musiques pop et rock, et au jazz : la charge physique, la magie du corps qui s’adonne aux rythmes et à la danse. Là se trouve le véritable clivage musical actuel […]. Il y a dans la percussion pure, dans l’excès et la joie rythmique le germe d’un renouveau musical permanent […]. La percussion seule, ainsi comprise, est à l’écriture rythmique ce que le quatuor fut à l’écriture harmonique : un substrat difficile, une épure implacable et limitée, un véritable retour aux sources […]. Pour longtemps encore, nos maîtres resteront les joueurs de tablas indiens ou de zarb iraniens, les paysans balinais, les percussionnistes africains et quelques inoubliables jazzmen » (Gérard Grisey « … Encore un peu de temps ! », Journal, Berkeley, Californie, février 1985)
Le Noir de l’étoile : musique intérieure, musique terrestre.
━━━━
Sources :
Philip Auslander, Glam rock : la subversion des genres, La Découverte/La rue musicale, 2015 (2006).
Jérôme Baillet, Gérard Grisey. Fondements d'une écriture, L’Harmattan, 2000.
Jeffrey Arlo Brown, The Life and Music of Gérard Grisey. Delirium and Form, University of Rochester Press, 2023.
Jen Christiansen, « Pop Culture Pulsar: Origin Story of Joy Division’s Unknown Pleasures Album Cover », https://www.scientificamerican.com/.
Gérard Grisey, Écrits, MF, 2019.
Jean-Pierre Luminet, « Musique avec pulsar obligé (à propos du Noir de l'Etoile, de Gérard Grisey) », Laboratoire Univers et théories, CNRS / Observatoire de Paris / Université Paris Cité, https://luth2.obspm.fr/.